Oui, à condition de ne pas être seul, à condition de se sentir proche d’une figure d’attachement qui ne nous quitte jamais.
John Bowlby, psychiatre et psychanalyste britannique (1907-1990) est à l’origine, avec notamment Anna Freud, Donald Winnicott et René Spitz, de la Théorie de l’attachement .
Le principe de base de la Théorie de l’attachement est qu’un jeune enfant a besoin, pour connaître un développement social et émotionnel normal, de développer une relation d’attachement avec au moins une personne qui prend soin de lui de façon cohérente et continue. Sinon, la vie ne vaut pas le coup d’être vécue, elle perd tout son sens.
À l’âge adulte, ce besoin de relation d’attachement persiste et se porte généralement sur le conjoint, sur une famille de coeur, sur des figures réelles, imaginaires, historiques, affectives, politiques, religieuses, spirituelles, culturelles de toute sorte.
Toutes ces figures sont des substituts parentaux dont l’objet transitionnel (le doudou) théorisé par Winnicott est le modèle originaire.

L’objet transitionnel
La vie vaut le coup si quelque chose ou quelqu’un (l’équivalent du doudou de mon enfance) me permet de me relier au monde en me détachant de ma mère, de mon père, de ma famille officielle, ma famille sur le papier, dont j’étais, de base, dans une dépendance angoissée.
Les relations familiales réelles, c’est compliqué, c’est pour ça qu’on échange la réalité contre des amis imaginaires, contre une famille imaginaire.

L’objet transitionnel permet de surmonter l’angoisse de la, séparation et de vivre loin de sa famille d’origine, pour construire une nouvelle vie, se faire de nouveaux amis, remplir sa vie de choses si nombreuses qu’on ne pourra jamais toutes les perdre en même temps, à moins de se perdre soi-même, ce qui n’arrivera jamais, puisqu’on n’est ni son corps, ni son esprit, ni l’union des deux, mais le doudou ultime: l’élan vital, en soi, hors de soi, partout présent, le doudou impossible à perdre.
Je suis, et toi aussi tu es, fait de sat-chit-ananda: l’existence absolue, la conscience pure, la félicité infinie. Voilà notre vraie nature. Nous ne sommes pas faits de chair et d’os, mais de lumière. Nous ne sommes pas nés de la poussière pour y retourner, nous sommes nés de l’éternité pour manifester l’éternité. Le corps et le monde sont des vêtements vivants et sensibles. L’esprit est un outil pour illuminer nos vêtements. Mais nous, nous sommes l’être impersonnel, le témoin silencieux derrière tout cela. Nous ne sommes ni vraiment nés, ni soumis au changement, ni destinés à mourir. Nous sommes comme l’espace: illimité, libre, toujours présent (cf Om).

Pour qui fait du yoga et s’intéresse à la spiritualité, cette quête d’attachement inconditionnel ressemble en tout point à la quête spirituelle traditionnelle de ce qu’on nomme un peu trop vite « détachement ».
Oui, nous cherchons à nous détacher de ce qui est éphémère mais c’est parce que nous avons besoin de nous relier à quelque chose d’éternel et de lumineux.
Cette chose éternelle et lumineuse, pour vous je ne sais pas, mais pour moi ce n’est pas un dieu, ni même la foi en un dieu créateur.
Cette chose éternelle, c’est la créativité elle-même.
Quand la créativité est au travail, la tradition indienne la nomme Shakti et l’associe, indissociablement, avec un principe de potentialité de création alternative, appelé Shiva.
Ce ne sont pas des dieux, ce sont des symboles, ce sont des concepts pour comprendre comment la vie fonctionne.
L’ »éternel », c’est l’élan vital, non spéciste, partagé entre le souci de se préserver et de préserver ce qui est vital pour se sentir complet: la diversité extérieure des formes de vie et d’existence de la matière sous toutes les formes possibles.
*
Tous autant que nous sommes, nous allons tous mourir, il ne restera de nous que l’élan vital partagé et soutenu par quelques souvenirs radieux. La spiritualité, c’est la reconnaissance et le partage de cet élan vital, élan vital qui demande tantôt à s’incarner dans les plaisirs et désirs de connexion terrestres, tantôt à demeurer loin de tout, désincarné, pur esprit, virtuel, juste une potentialité de vie infinie non réalisée. Ce qui, en Inde, s’appelle, sortir du samsara, sortir du cycle des incarnations successives, choisir de ne plus s’incarner.
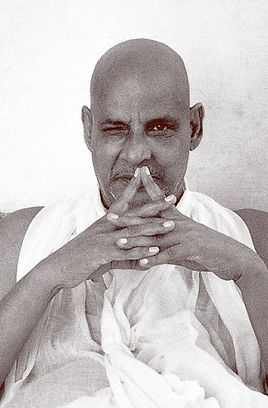
Que la spiritualité soit pour nous une perspective de réincarnation éternelle ou de désincarnation définitive, dans les deux cas nous échangeons une dépendance angoissée à la famille (famille qui peut trahir, faillir, mourir) contre une dépendance heureuse à quelque chose d’impossible à perdre.
Typiquement: une conception partagée de l’existence, de la vie, de ce que c’est que la spiritualité: mort acceptée et/ou renaissance possible.
On dit souvent qu’avant toute chose, nous avons besoin de donner un sens à notre vie. C’est en partie vrai mais c’est secondaire. En tout premier lieu, nous avons besoin de partager nos « doudous », autrement dit, de vivre des moments de plaisir réciproque, des postures, des techniques de vie, de yoga, des recettes de cuisine de toute sorte, en partageant telle musique que nous savons aussi appréciée par d’autres, en nous adonnant à tel loisir, en suivant telle discipline de vie, en commençant la guitare ou la peinture, en allant faire du shopping, en nous couchant dans l’herbe, en défendant tel parti politique, en promouvant telle école spirituelle, en jouant de bon cœur notre rôle dans la démocratie universelle, harmonieuse, conflictuelle, duelle, non duelle, paradoxale, bruissante, gourmande, pétillante, on ne peut plus intensément vivante.
Tout « le sens » que la vie peut avoir, va se greffer sur ces moments de partage reconnus à leur juste valeur, valeur spirituelle.
Même en lisant seul chez moi, je sais que, quelque part, quelqu’un lit aussi et rêve à ce que lui inspire ce qu’il lit.
Même en respirant seul chez moi, je sais que d’autres êtres respirent aussi, en prenant leur temps, en conscience, un peu comme s’ils lisaient attentivement un livre en s’arrêtant sur la poésie de chaque mot, en savourant de subtiles variations de rythme, en s’émerveillant de se connecter à tant de choses, à tant d’êtres, à tant de possibilités.
Quand on partage des moments de plaisir avec des proches dans un monde où, partout, d’autres êtres font de même, on se sent heureux, libre et compris. La vie vaut le coup d’être vécue. J’aime des choses et je peux les partager, je peux aimer avec les autres, je peux, aimer les autres, je peux aimer.

***